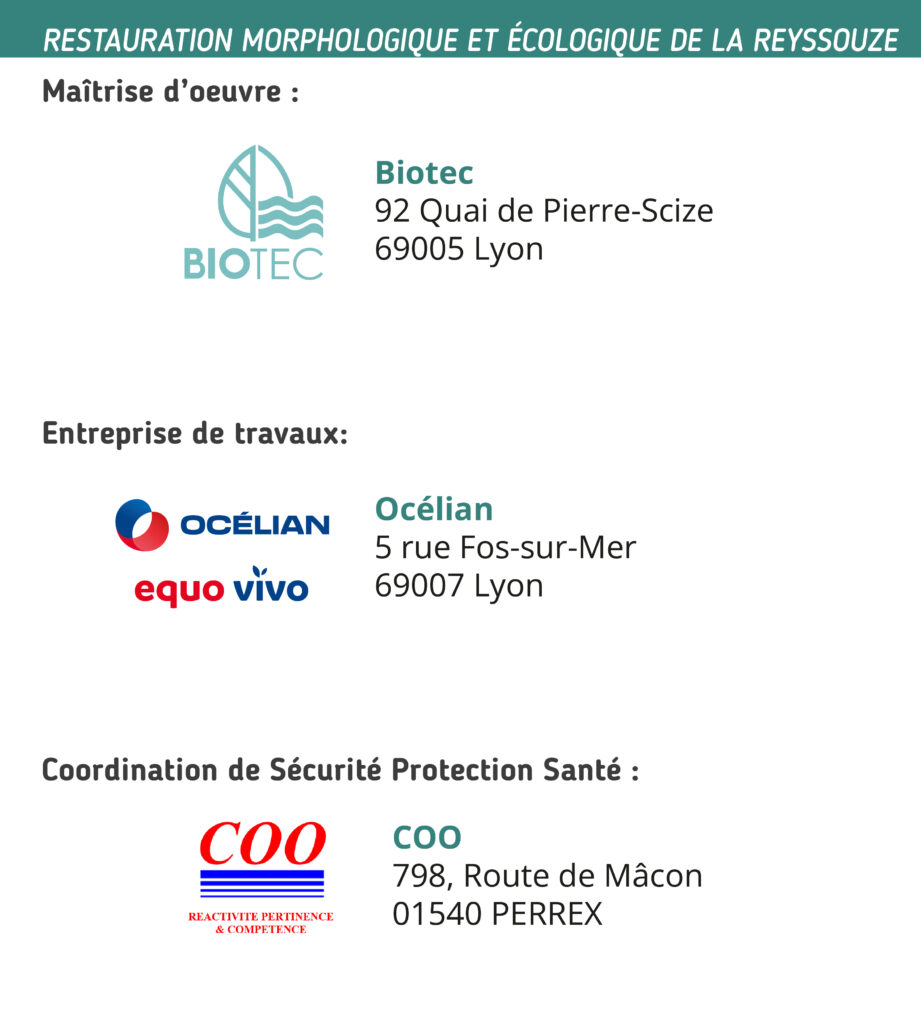Le curage est le retrait mécanique, depuis la berge, des sédiments accumulés dans le lit d’un cours d’eau. Il doit permettre d’accélérer l’écoulement des eaux pour limiter localement les risques d’inondations. Cette technique suscite des désaccords et aujourd’hui, le curage systématique des rivières n’est plus recommandé car il ne constitue pas une solution durable aux inondations.
Le curage peut en revanche aggraver l’érosion du lit et fragiliser les berges, créant des problèmes à plus long terme, comme l’incision du cours d’eau et l’érosion des berges, la déstabilisation des ponts …
Le rôle de Reyssouze et Affluents est de proposer une gestion des eaux de surface globale, en proposant des stratégies à l’échelle du bassin versant : évacuer l’eau le plus rapidement possible à un endroit entraîne forcément des conséquences sur l’écoulement des eaux en aval !
Nous privilégions aujourd’hui des solutions basées sur la nature. Les espaces humides, prairies et haies autour des rivières favorisent l’infiltration des eaux et ralentissent les écoulements. Combinés à des aménagements ciblés, comme l’aménagement de zones de débordement, ils permettent de mieux gérer les crues et d’atténuer les risques d’inondations.
Notre rôle est également de développer une culture du risque : les événements météorologiques extrêmes se multiplient avec le changement climatique, il nous faut apprendre collectivement à vivre avec.